Récit de vie : Louis Brunelet (1) - une jeunesse mouvementée.
- Alain THIREL-DAILLY
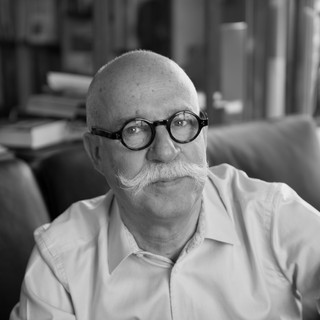
- 18 déc. 2024
- 8 min de lecture
C’est avec Auguste Joseph (1834-1874) que la branche BRUNELET qui mène aux aïeux de mon épouse, quitte les départements du Nord et de l’Aisne dont cette grande famille est originaire. Auguste est le petit-fils d’Alexis dont nous vous avons déjà partagé le récit de vie, à lire ou relire en cliquant ici.
Auguste, l’année de ses vingt ans, ne tire pas « le bon numéro » et doit effectuer ses 6 années de service militaire. Affecté au 75e régiment d'infanterie, il atteint le grade de sergent-fourrier et son dernier casernement est à la caserne Napoléon, érigée à Paris en 1854. Libéré de ses obligations militaires, il reste à Paris, nous sommes au début des années 1860.
À cette époque, il est domicilié rue de Charonne chez Marie Thomassin, récente veuve de Denis Beaufay, sculpteur sur bois. C’est ainsi, à n’en pas douter, qu’il s’éprend de la fille de sa logeuse, Marie Célina BEAUFAY (1834 - >1906). Âgés tous les deux de 29 ans, ils succombent, Marie se retrouve enceinte et, trois mois avant le terme, ils régularisent en se prenant pour époux. L’acte de mariage ne nous renseigne pas sur leurs professions respectives.
Venons-en, donc, à celui qui nous intéresse dans ce « récit de vie »…
Le 3 novembre 1863 vient au monde, à Paris, Louis Auguste BRUNELET (1863-1913) ; nous l'appellerons Louis. Sur l’acte de naissance, le père, « momentanément absent », est mentionné comme débitant de tabac, profession qu’il exerce avec son épouse, Marie Beaufay. C’est boulevard Saint-Martin, où le couple réside, que Louis commence donc sa vie.
Dans les années 1850 et 1860 s’ouvre en France « l’ère du rail ». Auguste y voit certainement une opportunité et c’est ainsi, sans que nous en connaissions la date exacte, qu’il embauche aux Chemins de fer du Nord. Peut-être y voit-il, aussi, un moyen de maintenir le lien avec sa région d’origine. Il fait manifestement le bon choix puisque, selon les sources familiales, il monte en grade, devenant « chef de bureau au contrôle ».

Le couple avance en âge et, choix ou circonstances, Louis reste enfant unique. La famille déménage à Argenteuil, dans le Val-d’Oise, où elle réside Grande rue, au recensement de 1872. Auguste est toujours employé aux Chemins de fer et son épouse, sans profession. Le développement du rail à Argenteuil n’en est encore qu’à ses débuts, avec seulement des lignes de tramway. C’est certainement par ce moyen qu’Auguste rejoint Paris, et notamment la gare du Nord où ses activités l’appellent.
Tout semble se passer pour le mieux quand, malheureusement, le drame arrive qui, sûrement, va faire basculer la vie de la famille et celle de Louis en particulier. Auguste décède brutalement, en service, à la gare du Nord. La veuve, pour subvenir à ses besoins, devient repasseuse et déménage avec Louis à Sannois. Ce dernier, qui a manifestement des capacités, devient apprenti typographe. Il a juste 15 ans quand sa mère se remarie avec un veuf, Gaspard Loubaud, marchand forain.
Louis prend rapidement son autonomie et exerce comme typographe à Paris, où il demeure. Même si, déjà, la vie est chère dans la capitale, les salaires dans la corporation des métiers du livre permettent de vivre, même chichement. Louis est-il quand même dans le besoin ou bien fait-il de mauvaises rencontres qui vont entraîner sa perte ? Bien que travaillant et demeurant à Paris, il reste certainement en contact avec sa mère, son beau-père et le milieu forain.
En effet, Louis, de passage dans le Val-d’Oise, se fait prendre pour le vol d’une boîte contenant une certaine somme d’argent au préjudice du sieur Blanrue, à Enghein. Il est immédiatement déféré et le tribunal correctionnel de Pontoise, dans son audience du 3 août 1881, le condamne à 15 jours d’emprisonnement. Il purge sa peine avant de recouvrer la liberté.
Notre jeune veut-il mettre de la distance avec ses relations, ou bien, au contraire, se laisse-t-il entraîner dans de nouveaux méfaits ? Un co-détenu lui aura-t-il donné de mauvais conseils ? Quelques mois plus tard, fin octobre, on le retrouve au Havre, où il travaille, semble-t-il, chez un certain Lecuyer, restaurateur rue de l’hôpital. Le 31 octobre, toujours au Havre, il soustrait frauduleusement un revolver au préjudice du sieur Sauvegrain dans la résidence duquel il s’introduit par effraction.

Louis vient récemment de se faire congédier de chez son patron qui l'a renvoyé. Louis, pour se venger de cette éviction, pénètre par escalade et effraction chez son ancien patron, le 3 novembre, trois jours après le vol du revolver. En brisant un carreau, il réussit à s’introduire dans la chambre de M Lecuyer, au premier étage, à forcer une armoire d’où il soustrait de l’argent et des titres pour une valeur de 2.000 fr environ. Prudent, il quitte Le Havre et s’en retourne à Paris où, pense-t-il sûrement, il ne risque pas de se faire épingler.
Las, 16 jours plus tard, la marée-chaussée vient le cueillir dans une imprimerie de la rue Amelot, où il a sans doute retrouvé un emploi. Maintenant, en attendant la comparution au tribunal, Louis est transféré à la prison Bonne Nouvelle à Rouen, ville où il doit être jugé. Déjà, à l’époque, la prison n’est pas toujours le meilleur lieu pour retrouver le droit chemin.

Le mardi 28 février 1882, la voiture cellulaire conduit de la prison Bonne-Nouvelle au palais de justice quelques prisonniers dont plusieurs doivent passer aux assises le lendemain. Louis est dans ladite voiture. Avec un complice, Orange, qui s’est déjà fait une solide réputation pour une série de vols avec effraction, ils réussissent à briser la porte du fourgon, pourtant fermée à clé, durant le transfert. Ils se font la belle au grand dam du brigadier de gendarmerie qui n’arrive pas à les rattraper. Les autres détenus ne s’enfuient pas ou n’en ont peut-être pas le temps. Le journal de Rouen, qui relate les faits, commente avec un peu d’ironie : « Quant à la manière dont les deux gredins avaient pu se sauver, en inspectant la voiture « cellulaire » on a reconnu qu’ils avaient tout simplement défoncé le montant de la porte sur lequel était vissée la gâche dans laquelle entre le pêne de la serrure. Si cette circonstance ne prouve guère en faveur de la solidité de la voiture « cellulaire » dont l’essieu se brisait avant-hier dans la rue Lafayette, ainsi que nous l’avons raconté, en revanche, elle atteste la vigueur musculaire et la dextérité de nos deux gaillards. »

Le parquet est prévenu, le signalement des fuyards diffusé dans toutes les brigades de gendarmerie environnantes et chacun pense que, sans ressources, ils ne pourront vraisemblablement pas aller bien loin. La suite nous prouvera que c’est mal les connaitre. Comble d’audace, quelques heures après leur fuite, les deux comparses volent, dans la rue du marché, un cheval et une voiture afin de poursuivre leur cavale. C’est le boucher Daniel, place du Vieux-Marché, qui en fait les frais. On ne leur donne pourtant pas grande chance de réussir leur évasion quand on apprend que le cheval qu’ils ont volé est boiteux…
Pourtant, Orange et Brunelet, comme les appelle la presse, réussissent à quitter Rouen, en direction de la région parisienne. Le cheval, malgré son infirmité, les amène jusqu’à Suzay, dans l’Eure, commune distante d’un peu plus de quarante kilomètres de Rouen. Après une nuit de voyage, conscient que leur cheval ne les mènera pas bien plus loin, ils s’adressent vers 7 heures du matin à un aubergiste du lieu pour remiser le cheval et la voiture. Ils lui déclarent devoir aller à Magny et revenir le lendemain chercher voiture et cheval. Très vite, ils quittent les lieux, sans la moindre intention de revenir, pour tenter de rejoindre Paris.
C’est ainsi qu’ils arrivent à pied, à 6 kilomètres de là, dans la commune des Thilliers-en-Vexin. Les gendarmes, alertés par leur attitude qu’ils jugent suspecte, ne se doutent pas qu’ils ont affaire aux deux prisonniers évadés de Rouen, mais les arrêtent simplement comme vagabonds. Les deux jeunes déclarent s’appeler Bonnard et Poisson, mais ne pas être en possession de leurs papiers. Le brigadier, en les enfermant dans la chambre de sûreté, entend l’un des deux dire à son collègue : « Si nous étions passés avec la « roulante » [la voiture à cheval] nous ne serions pas pincés. » Apprenant le lendemain qu’une voiture avait été volée à Rouen et qu’on soupçonnait les deux évadés de l’avoir volée, le brigadier les interrogea sur ce point, mais ils nièrent énergiquement. Ce n’est que quelques heures après qu’une dépêche est venue éclairer les gendarmes sur l’importance de la double capture qu’ils ont faite. Les deux loustics sont obligés de passer aux aveux avant d’être mis à la disposition du parquet des Andelys qui informe le parquet de Rouen.
Ce samedi 4 mars au matin, Orange et Brunelet sont finalement ramenés à Rouen par la gendarmerie des Andelys, certainement plus vigilante que leurs collègues rouennais. Ils réintègrent donc Bonne-Nouvelle, en attendant leur jugement. Orange comparait le premier, dès le lundi suivant, 6 mars. Les affaires se présentent mal pour lui, au passif beaucoup plus lourd, qui a dû faire des confidences à son compagnon de fuite. Louis Brunelet, au cours d’un interrogatoire musclé, lâche certaines indications qui permettent à la police de découvrir le lieu où Orange cache ses butins, dans une maison située à Bihorel.
Henri Auguste Orange, 35 ans, soit près du double de Louis, est un enfant naturel né de père inconnu. Le dossier est très lourd, avec une liste étonnante de méfaits, pour lesquels il a déjà purgé des peines de prison. Son attitude, au procès, ne jouera pas en sa faveur, si l’on en croit la presse : « Orange n'a pas une de ces physionomies de coquin endurci, de criminel intelligent, qu'on rencontre quelques fois sur le banc des accusés ; soit qu'il ait cru de son intérêt de dissimuler son caractère devant le jury sous le masque d'une placidité frisant l'abrutissement, soit que, réellement, il ait perdu l'intelligence, et que sa nouvelle incarcération l'ait fait abandonner toute velléité de résistance ou de discussion, il a été à l'audience d'un terne et d'un plat qui, sans doute, ont désillusionné rapidement le public sur le genre d'intérêt qu'il venait demander au débat. Orange a avoué certains de ses vols ; il a nié les autres ; il n'a donné aucun détail sur son évasion. » Déclaré coupable, sans circonstances atténuantes, Orange a été condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Louis, de son côté, n’attend que quelques jours puisqu’il est présenté devant la cour d’assises de la Seine-Inférieure le samedi 11 mars. La séance est présidée par M. le conseiller Fournot, et Louis Auguste Brunelet est défendu par Me Lanne. La chronique judiciaire du Journal de Rouen décrit Louis Auguste Brunelet comme « jeune et audacieux, très calme, très froid dans la résolution et énergique dans l’éxécution ». Il a une mauvaise attitude à l’audience ; ainsi le jury et la cour l’ont-ils frappé sévèrement. »
La sentence est lourde : Louis est condamné à huit ans de travaux forcés, sans surveillance.

Les deux hommes sont écroués le même jour, le 6 avril 1882, à Saint-Martin-de-Ré, dépôt pour le regroupement des prisonniers destinés à être envoyés au bagne. Henri Orange qui, contrairement à Louis Brunelet, n’a pas interjeté de pourvoi, embarque le 10 mai 1882 sur le Fontenoy pour le bagne de Nouvelle-Calédonie.
Louis, quant à lui, séjournera près d’un an au dépôt, tant que le pourvoi en cassation n’est pas instruit et, finalement, rejeté. C’est le 8 mars 1883, un an plus tard, qu’il embarque sur la goélette « Le Navarin ». Après trois mois de traversée, il découvre le bagne calédonien, le 28 juin 1883, pour y exécuter sa peine.


Suite de ce "récit de vie" de Louis Brunelet, dans un prochain article.
Le Récit-de-vie
Il s'agit, dans un article unique, ou bien dans une suite d'articles, de raconter en la contextualisant, la vie d'un ancêtre, d'un collatéral, d'une famille, voire même d'un village ou d'une paroisse.
Devenez membre du site, pour suivre les "Récit-de-vie".
Vous pourrez ainsi commentez et échanger avec les autres membres du site... et encourager l'auteur de ce site
En quelques clics, en haut de toutes les pages du site, suivre les instructions :








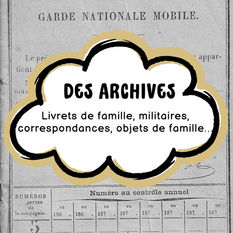
Bravo pour cette enquête palpitante, ravi de te revoir !